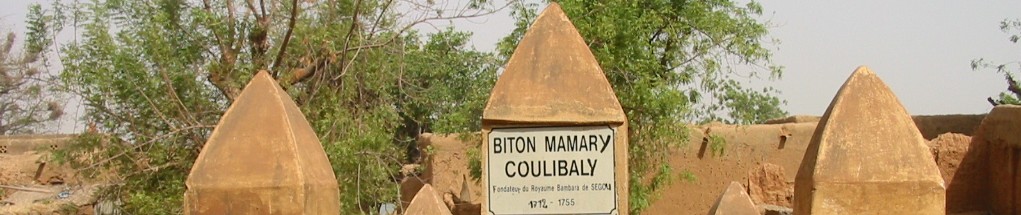Vers les deux heures après midi, je dormais tranquillement sur une peau de bœuf, lorsque je fus réveillé par les clameurs des femmes et les cris confus de tous les habitants. Je crus d’abord que les Bambaras étaient entrés dans la ville. Ayant aperçu mon domestique assis sur le toit d’une chaumière, je l’appelai pour savoir ce qui causait une si grande terreur. Il me dit que les Maures revenaient pour voler du bétail, et qu’ils étaient déjà tout près de nous. Je montai sur le toit, et je vis cinq Maures à cheval qui, avec leurs mousquets, poussaient vers la ville un grand troupeau de bœufs. Lorsque les Maures furent près des abreuvoirs qui sont à côté de la ville, ils choisirent seize des plus beaux bœufs, et s’enfuirent au galop.
Pendant tout ce temps-là, les habitants s’étaient assemblés près des murailles de la ville, au nombre de plus de cinq cents ; et quand les Maures emmenèrent leur bétail ils passèrent auprès d’eux à la portée du pistolet, sans qu’ils osassent faire aucune résistance. Ils tirèrent à la vérité quatre coups de fusil, mais comme ces fusils étaient chargés avec de la poudre fabriquée par les Nègres ils ne firent point d’effet.
Quelques moments après, je vis une troupe de gens qui portaient un jeune homme à cheval et s’avançaient à petits pas vers la ville. C’était un des gardiens des troupeaux, lequel, ayant menacé les Maures de les percer de sa lance, avait reçu un coup de fusil d’un de ces brigands. La mère du jeune homme, égarée par la douleur, marchait devant la troupe, frappant ses mains l’une contre l’autre et faisant l’énumération des bonnes qualités de son fils. « Eé maffo fonio (Il n’a jamais dit de mensonge) », criait cette mère désolée, tandis qu’on faisait entrer son fils dans la ville. « Eé maffo fonio abada (Il n’a jamais dit de mensonge, jamais (de abâdâ(n), en arabe) ) » Lorsqu’on l’eut porté dans sa chaumière et étendu sur une natte, tous les spectateurs déplorèrent son sort, et poussèrent des cris et des gémissements de la manière la plus touchante.
Après que leur douleur fut un peu calmée, on me pria d’examiner le blessé. Je trouvai que la balle avait percé sa jambe de part en part, et lui avait brisé les deux os un peu au-dessous du genou. Le pauvre jeune homme avait tant perdu de sang qu’il s’était évanoui, et son état était si incertain qu’il me fut impossible de donner à ses parents beaucoup d’espoir sur sa guérison. Cependant, pour rendre cette guérison possible, je leur observai que je croyais nécessaire de lui couper la jambe au-dessus du genou. Cette proposition les fit tous frémir d’horreur. N’ayant jamais entendu parler d’une pareille manière de guérir, ils ne voulurent pas consentir à me la voir employer. Ils me regardèrent comme un cannibale, parce que j’offrais d’entreprendre une opération qui, suivant eux, était plus cruelle, plus douloureuse et plus dangereuse peut-être que la blessure même.
Le malade fut confié aux soins de quelques vieux buschréens, qui travaillèrent à lui assurer son entrée dans le paradis, en marmottant à ses oreilles quelques phrases arabes, qu’ils l’invitaient à répéter avec eux. Après plusieurs efforts inutiles, le pauvre païen prononça enfin ces mots : « La Illha el alla, Mahomet razoul allahi. » Aussitôt les disciples de Mahomet déclarèrent à la mère du jeune homme que son fils venait de donner une preuve suffisante de sa foi pour être heureux dans l’autre vie. Il mourut le même soir.