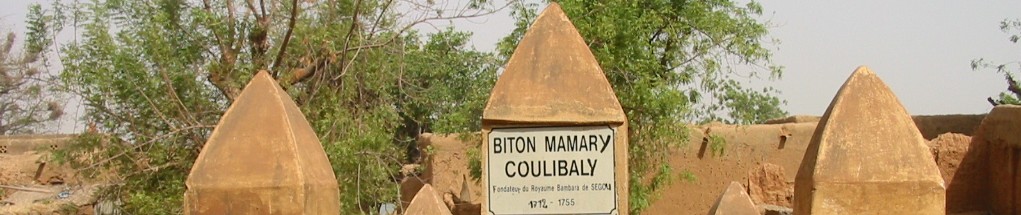Le 15, le Charlestown, vaisseau américain commandé par M. Charles Harris, entra dans la rivière. Il venait chercher des esclaves, se proposant de toucher à Gorée pour s’en pourvoir et de se rendre de là à la Caroline méridionale. Comme les marchands européens établis sur la Gambie avaient alors beaucoup d’esclaves sur les bras, ils convinrent avec le capitaine d’acheter la totalité de sa cargaison, qui consistait principalement en rhum et en tabac, et de lui en payer le montant en esclaves, dans le terme de deux jours.
Cette circonstance m’offrait une si belle occasion de retourner dans ma patrie, quoique par une voie éloignée, que je ne crus pas devoir la négliger. J’arrêtai donc sur-le-champ mon passage sur ce vaisseau pour aller en Amérique, et ayant pris congé et du docteur Laidley à qui j’avais tant d’obligations, et des autres amis que j’avais dans le pays, je m’embarquai à Kaye le 17 juin.
Notre navigation jusqu’au bas de la rivière fut ennuyeuse et pénible ; le temps était si chaud, si humide et si malsain qu’avant notre arrivée à Gorée quatre matelots, le chirurgien et trois esclaves étaient morts de la fièvre. Nous fûmes obligés, faute de vivres, de rester à Gorée jusqu’au commencement d’octobre.
Le nombre des esclaves embarqués à bord de ce vaisseau, tant sur la Gambie qu’à Gorée, était de cent trente, dont environ vingt-cinq, je crois, avaient été en Afrique de condition libre. Ceux-ci pour la plupart étaient buschréens et sachant écrire un peu d’arabe. Neuf avaient été faits prisonniers dans la guerre de religion qui avait eu lieu entre Abdulkader et Damel, et que j’ai rapportée à la fin du précédent chapitre. Deux autres m’avaient vu quand j’avais passé à Bondou, et plusieurs avaient entendu parler de moi dans l’intérieur du pays. Ma conversation avec eux dans leur langage leur faisait grand plaisir, et, le chirurgien étant mort, je consentis à le remplacer pour le reste du voyage.
Les pauvres Nègres avaient véritablement besoin de toutes les consolations qu’il était en mon pouvoir de leur donner : non pas que je remarquasse qu’il fût commis contre eux aucun acte de cruauté ni par le capitaine ni par les gens de l’équipage, mais, la manière dont sur les vaisseaux négriers américains on enferme et l’on attache les Nègres étant, à cause de la faiblesse des équipages, beaucoup plus sévère que la méthode usitée sur les bâtiments anglais employés à ce trafic, ces malheureux souffraient beaucoup, et une maladie générale régnait parmi eux. Outre les trois qui étaient morts sur la Gambie, et six ou huit qui périrent à Gorée, il en mourut onze en mer, et plusieurs de ceux qui résistèrent étaient dans un triste état de faiblesse et de maigreur.
Pour augmenter ces maux, le vaisseau, après avoir été trois semaines en mer, commença à faire tant d’eau qu’il fallait sans cesse travailler aux pompes. On trouva donc à propos d’ôter des fers quelques-uns des plus vigoureux Nègres, pour les employer à ce travail, et on les y appliqua souvent au-delà de leurs forces. Il en résulta une complication de peines difficile à décrire. Cependant, nous fûmes soulagés plus promptement que je ne l’espérais, car, la voie d’eau continuant à nous gagner, l’équipage exigea que le bâtiment se rendît aux îles de l’Amérique, seule ressource qui nous restât pour nous sauver la vie. En conséquence, après quelques difficultés de la part du capitaine nous nous dirigeâmes vers Antigoa, où nous arrivâmes heureusement vingt-cinq jours après notre départ de Gorée. A l’instant même de notre arrivée, nous fûmes encore sur le point de périr. En approchant du côté nord-ouest de l’île, nous touchâmes sur le rocher le Diamant et n’entrâmes qu’avec beaucoup de peine dans le port de Saint-Jean. Le vaisseau fut ensuite condamné comme ne pouvant plus tenir la mer, et les esclaves, m’a-t-on dit, durent être vendus pour le compte des propriétaires.