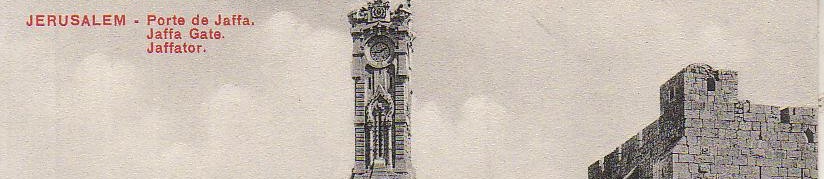Nous venons de faire connaître l’état de la Syrie et du Liban jusqu’en 1840 ; nous avons donné un aperçu des diverses populations, de leurs moeurs et de leur caractère, de leurs discordes et des
causes qui les ont produites. Nous allons maintenant aborder une question singulièrement délicate, et où nous nous exposons à des critiques passionnées ou même à de vives inimitiés ; mais, en com-
mençant ce livre, nous nous sommes engagé à dire la vérité tout entière, quel qu’en soit le péril. Nous voulons parler des consulats et des protections illégalement accordées aux Arabes.
Aucune province de l’empire, aucun pays du monde ne possède autant de consulats et d’agences consulaires que la Syrie. Sans parler des grandes villes où résident des sujets européens et dans
lesquelles des consuls sont nécessaires pour défendre les intérêts de leurs nationaux, nous en trouvons à Urfa, Marash, Ayntab, Antioche, Suwaidiya, Iskenderun, Ladhaqiya, Tripoli, Saïda, Acre, Haïffa, Yaffa, Ramla. Partout flottent les pavillons des puissances étrangères. Nous n’attaquons pas le principe, il est bon que l’Europe ait les yeux sur cette province. Mais, pour un avantage qui peut en résulter, on découvre mille inconvénients. Les agents consulaires, et ils se comptent par centaines, n’ont pas besoin de firmans pour être reconnus. Le consul ou consul général duquel dépend la ville où une agence consulaire va être créée, demande une lettre de créance au gouverneur général, pour tel ou tel individu. Cette lettre est adressée au caïmakam ou mudir de l’endroit, et voilà une puissance établie. Tous ces consulats sont des États dans l’État, des pierres d’achoppement où viennent se briser toutes les bonnes intentions des gouverneurs. Quelquefois même des consulats sont donnés au plus offrant.
Souvent, et ceci sous la réserve que le corps consulaire compte des titulaires de la plus parfaite honorabilité; souvent, disons-nous, les agences consulaires sont vendues presque publiquement; d’autres sont obtenues par faveur, par intrigue. Les employés subalternes
ont intérêt à faire réussir leurs candidats, ce qui donne lieu à des comédies sans nom.
Lorsque le consul est depuis peu arrivé d’Europe, qu’il ne connaît encore ni les moeurs, ni les coutumes du pays, il se trouve circonvenu, et on lui arrache une acceptation pour des protégés que l’on représente comme les plus honnêtes gens du monde, mais qui, en réalité, ont une réputation des plus douteuses. On se partage ensuite le prix convenu d’avance.
Parfois, pourtant, la somme promise n’est acquittée qu’en partie, ou ne l’est point du tout. Les employés la réclament en vain à l’aspirant consulaire qui a déjà sa nomination en poche. Alors l’honnête homme de la veille devient le fripon du lendemain. Le consul ne sait à qui croire, mais il est tellement sollicité, obsédé, qu’il promet une destitution. D’autres fois encore, l’individu à qui l’on avait promis un poste, paye d’avance une certaine somme à ces mêmes employés subalternes. Le poste étant donné à un autre, ce
sont des réclamations et des procès scandaleux.
Et ceci n’est pas un conte forgé à plaisir.
Tous les habitants de Beyrouth, d’Alep et de Jérusalem vous raconteront les mêmes faits. Un agent consulaire ayant fait de grandes dépenses pour arriver à son poste, il faut qu’il retrouve son argent. Alors il se met à faire la vente des protections ; un agent consulaire, contrairement aux traités et aux capitulations, aura jusqu’à quatre drogmans, quatre ou cinq cavass, des commis, des copistes, des traducteurs. Tous ces gens-là lui achètent à beaux deniers le droit d’échapper au gouvernement direct de la Sublime Porte.
A Alep, l’agent consulaire de Perse avait, en 1860, environ vingt-quatre cavass, qui tous lui payaient une redevance. Tous ces drogmans, commis et cavass sous-louent,à leur tour, la
protection qu’ils ont obtenue, à des soi-disant associés, frères ou amis, et rentrent en partie dans la somme qu’ils ont déboursée. Ceci regarde les protégés-employés.
Parlons maintenant d’une autre classe de protégés. Un sujet européen, négociant ou non, a le droit, en Syrie (un droit non écrit et non admissible), d’avoir cinquante employés, tels que commis, magasiniers, courtiers, portefaix, etc., qui tous jouissent de la protection consulaire. Nous avons connu à Alep une vieille femme veuve, vivant du loyer de quelques magasins; elle protégeait, ou, pour mieux dire, elle couvrait de la protection de son consul six négociants indigènes dix fois plus ri-
ches qu’elle, et qui passaient, l’un pour son commis, l’autre pour son homme d’affaires, un autre pour son domestique. Avec ce système on va loin, très-loin même.
L’autorité se saisit-elle d’un délinquant, sujet turc de père en fils, un consulat quelconque le clame comme son protégé, et le gouverneur, s’il n’est pas doué d’une grande énergie, le relâche immédiatement.
Un raya a-t-il un procès avec un de ces protégés, son affaire, contrairement aux traités et aux capitulations, sera portée, non devant les tribunaux turcs, mais devant le consulat : 99/100, le raya est condamné.
Dans un voyage que nous fîmes, il y a quelque temps, à Alexandrie, nous rencontrâmes sur le bateau à vapeur M. Salemann, vice-consul de Russie dans cette ville. Nous causâmes; la discussion tomba sur les différences qui existent entre l’Egypte et la Turquie.« En Egypte, dit le vice-consul, les Européens font tout ce qu’ils veulent. Pour qu’un raya ou un Turc ait raison, il faut que sa cause soit plus
claire que le soleil; s’il a quatre fois raison, alors peut-être justice lui sera-t-elle faite. » Cela s’applique tout aussi bien à la Syrie, et les consuls n’en sont pas toujours coupables. Ils sont tellement entourés, influencés, qu’ils font parfois à leur insu triompher les causes les plus injustes. Les gouverneurs, surtout dans ces dernières années, voyant ce mal, s’en affligeaient, mais ne pouvaient
pas y porter remède. Pourquoi ? Leurs instructions de Constantinople disaient: « Tâchez de nous donner le moins d’embarras possible avec les ambassades. » Le « moins d’embarras «signifiait, pour
les gouverneurs insouciants « aucun embarras; » et ils laissaient faire, sans s’inquiéter de ce fait, que les abus ainsi tolérés acquéraient quelquefois force de loi.
Une autre plaie de la Syrie, ce sont les drogmans.
Nous avons dit que chaque consul, qu’il y fût autorisé ou non, avait cinq, six, jusqu’à huit drogmans non payés. Ces messieurs se tiennent presque sans cesse près du sérail du gouverneur, où ils guettent des pratiques. Une affaire scabreuse se présente : n’importe à quelle nationalité appartiennent les parties, le drogman s’en empare, la fait sienne, et l’administration turque est obligée de compter avec lui comme s’il était partie lui-même. Si l’autorité ne cède pas au drogman, celui-ci va faire à son consulat des plaintes amères contre l’injustice, la mauvaise organisation des tribunaux, contre la législation et la vénalité du gouverneur, et c’est sur ces données que la plupart des consuls font leur rapport. Il y a en Syrie 300 ou 400 personnes qui vivent de cette industrie singulièrement lucrative. Quelques-uns, et nous pourrions les citer, y ont fait des fortunes aussi énormes que scandaleuses.
A qui la faute? disent les détracteurs de la Turquie, et ils répondront : au gouvernement local, avec un semblant de vérité pour qui ignore la Turquie et l’extrême tolérance qu’on y montre envers
tout ce qui est européen. Mais, en réalité, la faute en est aux ambassades, abusées par des gens à qui elles accordent une confiance qu’ils ne méritent pas. Il en faut accuser aussi cette lutte incessante des influences étrangères, qui fait trouver mauvais par tel ambassadeur tout ce que son collègue propose; et ces capitulations surannées qui furent accordées à des Européens, gens de haute honorabilité venant en Turquie pour y faire un séjour momentané, et qui étaient tenus à déposer de fortes sommes d’argent en garantie de leur retour dans leur pays.
Nous n’en avons pas fini avec les protections.
Partout où en Syrie il existe des consulats, des agents consulaires ou des agents de ces agents, le nombre des protégés est illimité Mais si le gouvernement turc est paternel, pourquoi ses sujets cherchent-ils à passer sous une juridiction étrangère? La réponse est facile ; on cherche une protection étrangère pour jouir des avantages accordés par les capitulations et les traités, pour en abuser même, pour ne pas payer les contributions extraordinaires qui pèsent sur les sujets turcs ; quelquefois même, c’est pour être mauvais débiteur, banqueroutier, faussaire, en se retranchant derrière certains articles des codes européens fort mal connus, et encore plus mal interprétés.
On acquiert une protection du jour au lendemain, on en change avec la même facilité. Est-on condamné au tribunal d’un consul éclairé, honnête et ferme (et certes il y en a beaucoup), on rede-
vient immédiatement sujet turc pour repasser quelques jours plus tard sous l’autorité d’un autre consulat, si l’autorité locale a prononcé contre vous.
Il y a trois ans, 6000 Krûm-li de la province de Trébizonde, ayant reçu l’autorisation d’abandonner le culte de Muhammad qu’ils suivaient depuis 400 ans, pour rentrer dans la religion de leurs premiers ancêtres, voulurent aussi changer de nationalité. Un voyage de quinze jours à Kutaïs leur en fournit le moyen. Le gouvernement de Saint-Pétersbourg leur ayant donné des passeports pour circuler à l’intérieur de la Russie, ils s’en servirent pour réclamer la protection russe en rentrant dans leur patrie. Le consul la leur accorda, et ce n’est qu’à grand’peine et grâce à la fermeté du gouverneur de cette province qui se sentait appuyé par le grand vizir Ali-Pacha et le ministre des affaires étrangères Fuad-Pacha, qu’ils purent être contraints à déchirer le papier constatant leur nouvelle nationalité.
En Syrie il n’est pas même nécessaire de sortir des murs d’une ville pour jouir des privilèges que donne un passeport. Des individus qui n’ont jamais quitté Alep, Beyrouth, Tripoli, ou Damas, sont aujourd’hui munis de papiers officiels, constatant qu’ils sont nés, celui-ci à Alexandropol, celui-là à Hambourg, cet autre à Brème ou à Lubeck.
Plus d’une fois le gouvernement turc voulut mettre ordre à cet état de choses. Le 14 septembre 1860, un mémorandum de S. A. Ali-Pacha proscrivait les protections et demandait aux ambassadeurs qu’ils donnassent à leurs agents des instructions nécessaires pour la répression de ces abus. Par malheur la question de Syrie était à l’ordre du jour et les prescriptions de Constantinople ne furent pas suivies. Les journaux abondent en plaintes contre l’abus des protections.
[…]
Les Turcs ne sont plus les maîtres chez eux, entend-on dire chaque jour en Syrie. Jamais parole n’a été plus vraie. Ont-ils raison dans un procès, on est forcé de leur donner tort. On se plaint du joug sous lequel sont maintenues les populations chrétiennes. On devrait plaindre au contraire les Turcs d’avoir à subir tant d’avanies. Pour faire le commerce en Syrie, il est nécessaire à un indigène de connaître non-seulement les lois qui régissent son pays, mais encore les codes de toutes les autres puissances; sinon il est ruiné au bout de six mois.
Cet état de choses, qui mériterait plus de développement que n’en comporte notre cadre, doit finir par exaspérer les masses.
Skene, consul anglais à Alep, rapport de 1852 : « les chrétiens ont cruellement souffert sous la main des musulmans, mais cette explosion avait des causes particulières, et elle n’a point laissé de traces. La condition des chrétiens s’est même améliorée de manière à devenir dangereuse pour eux ; les musulmans sont jaloux de leur prospérité commerciale et exaspérés par l’arrogance des chrétiens quand ceux-ci sont protégés par les consuls européens. »