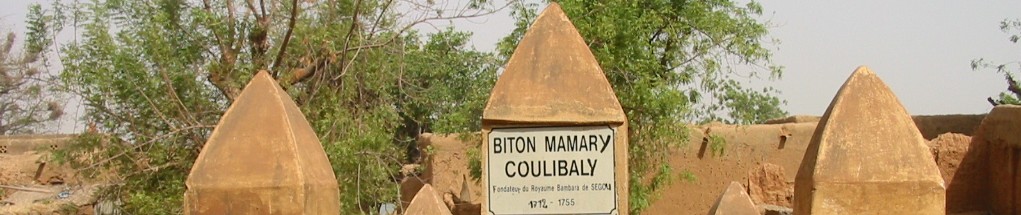Vers les cinq heures du soir, nous arrivâmes à Sansanding, très grande ville qui contient, me dit-on, de 8 à 10 000 habitants. Ce lieu est très fréquenté par les Maures, qui y apportent de Beerou du sel et de la Méditerranée de la verroterie et du corail, pour les y échanger contre de la poudre d’or et de la toile de coton. Ils vendent cette toile avec un grand bénéfice à Beerou et dans les autres pays maures, où, à raison du défaut de pluie, on ne cultive point de coton.
[…] Pendant que nous passions, il arriva trois autres canots, dont deux portaient des passagers, et l’autre des marchandises. Je vis avec satisfaction que tous les habitants nègres me prenaient pour un Maure. J’aurais probablement passé sous ce titre sans aucun obstacle si un Maure qui était assis près du rivage n’eût découvert l’erreur et, jetant un cri, n’eût rassemblé un grand nombre de ses compatriotes.
Lorsque j’arrivai à la demeure de Counti Mamadi, le douty de la ville, je me vis environné de quelques centaines de personnes qui parlaient différents dialectes tous aussi peu intelligibles pour moi les uns que les autres. Enfin, par le secours de mon guide qui me servait d’interprète, je compris que quelques-uns des spectateurs prétendaient m’avoir vu dans un lieu, et d’autres dans un autre. Une femme maure jurait positivement qu’elle avait tenu ma maison pendant trois ans à Gallam, sur la rivière du Sénégal. Il était clair que ces gens me prenaient pour quelque autre personne, et je priai deux des plus confiants de dire de quel côté était le lieu où ils m’avaient vu. Ils montrèrent le sud ; je présumai de là qu’ils venaient probablement du cap Cote, où il était possible qu’ils eussent vu quelques Blancs. Leur langage ne ressemblait à aucun de ceux que j’avais déjà entendus. Les Maures, s’étant alors assemblés en grand nombre, forcèrent, avec leur arrogance ordinaire, les Nègres à se tenir à l’écart. Ils commencèrent par me questionner sur ma religion mais, trouvant que je ne savais pas bien l’arabe, ils envoyèrent chercher deux hommes, qu’ils appelaient ilhuidi (juifs), dans l’espoir que ceux-ci pourraient causer avec moi. Ces juifs, pour le vêtement et l’extérieur, ressemblent beaucoup à des Arabes. Mais, quoiqu’ils se conforment à la religion de Mahomet, au point de réciter en public les prières du Koran, ils sont peu respectés par les Nègres. Les Maures eux-mêmes avouèrent que, tout chrétien que je fusse, j’étais un meilleur homme qu’un juif. Ils prétendirent cependant que je devais, comme les juifs, me conformer à leur religion et répéter les prières mahométanes ; et lorsque je tentai d’éluder ce point en disant que je ne savais pas l’arabe l’un d’eux, schérif de Tuat dans le Grand Désert, se leva et jura par le prophète que si je refusais d’aller à la mosquée il aiderait ceux qui voudraient m’y traîner. Il n’y a nul doute que cette menace n’eût été mise sur-le-champ à exécution si mon hôte ne fût intervenu en ma faveur. Il leur dit que j’étais l’étranger du roi et qu’il ne pouvait consentir à me voir maltraiter pendant que j’étais sous sa protection. Il leur conseillait donc de me laisser tranquille pour le soir, les assurant que le lendemain on me ferait partir ; cela apaisa un peu leurs clameurs, mais ils me forcèrent de monter sur un siège élevé, près de la porte de la mosquée, pour que chacun pût me voir, car la foule était devenue si nombreuse qu’on ne pouvait plus la contenir. Des gens montaient sur les maisons et grimpaient les uns sur les autres, comme font parmi nous les spectateurs d’une exécution judiciaire. Je restai sur ce siège jusqu’au coucher du soleil. On me conduisit alors dans une cabane assez propre, au-devant de laquelle était une petite cour dont Counti Mamadi ferma la porte pour empêcher que personne ne m’importunât, mais cette précaution ne put écarter les Maures. Ils gravirent par-dessus le mur de terre et vinrent en foule dans la cour pour me voir, disaient-ils, faire mes dévotions du soir et manger des œufs. Je ne jugeai pas à propos de les satisfaire sur le premier article, mais je leur dis que je n’avais point de répugnance à manger des œufs s’ils voulaient m’en donner.
Mon hôte m’apporta sur-le-champ sept œufs de poule, et fut fort étonné de voir que je ne pouvais les manger crus ; car c’est, ce semble, une opinion généralement reçue parmi les habitants de l’intérieur que les Européens vivent presque uniquement de cette nourriture. Lorsque je fus venu à bout de persuader à mon hôte que cette opinion était mal fondée et que je prendrais volontiers ma part de tous les mets qu’il voudrait bien m’envoyer, il ordonna qu’on tuât un mouton et qu’on en préparât une partie pour mon souper.
Vers minuit, lorsque les Maures m’eurent quitté, il me fit une visite et me pria avec beaucoup d’insistances de lui écrire un saphi.
« Si le saphi d’un Maure est bon, disait cet hospitalier vieillard, celui d’un Blanc doit nécessairement être meilleur. »
Je lui en donnai volontiers un, pourvu de toutes les vertus que je pouvais y mettre, car il contenait l’oraison dominicale. La plume avec laquelle je l’écrivis était un morceau de roseau ; un peu de charbon et d’eau gommée me firent une encre passable et une planche mince me servit de papier.