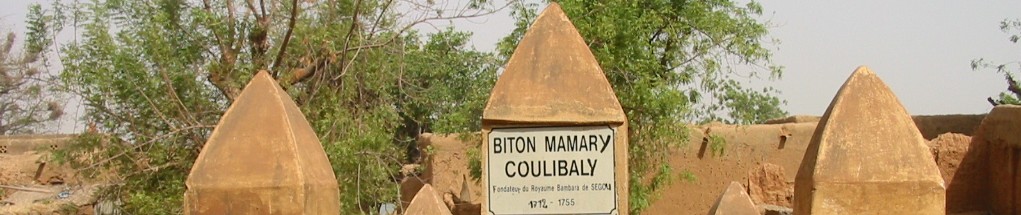A midi, nous entrâmes dans la ville de Fatteconda, capitale du royaume de Bondou, et peu après nous fûmes invités à aller loger dans la maison d’un très estimable slatée. Les villes d’Afrique n’ont point d’auberges, de sorte qu’en y arrivant les étrangers se rendent au bentang, ou dans quelqu’autre lieu public, et quelque habitant ne tarde pas à aller leur offrir l’hospitalité.
Nous nous rendîmes à l’invitation du slatée. Environ une heure après, un homme vint me trouver et me dit qu’il était chargé de me conduire auprès du roi, qui, si je n’étais pas trop fatigué, désirait de me voir à l’instant.
Je pris mon interprète avec moi et suivis le messager. Nous étions sortis de la ville et avions déjà traversé quelques champs de millet lorsqu’il me vint dans l’idée qu’on cherchait à me jouer un tour. Je m’arrêtai et demandai au messager où il prétendait me conduire. Alors il me montra à quelque distance un homme assis sous un arbre et me dit que le roi donnait souvent audience de cette manière, afin de ne pas être importuné par la foule. Il ajouta que moi et mon interprète nous pouvions seuls approcher du monarque.
Lorsque je fus près du roi, ce prince m’invita à me placer sur la natte où il était assis. Je lui dis quel était l’objet de mon voyage, sur quoi il ne fit pas la moindre observation, mais il me demanda si je voulais acheter des esclaves ou de l’or. Je lui répondis que non, et il en parut très surpris. Ensuite il m’invita à venir le voir dans la soirée, parce qu’il voulait me faire présent de quelques provisions.
Quoique ce monarque fût attaché non à la secte de Mahomet, mais au paganisme, il portait le nom maure d’Almami. L’on m’avait raconté qu’il s’était conduit avec beaucoup de malveillance envers le major Houghton, et que c’était par ses ordres que ce voyageur avait été pillé. Aussi, quoique dans notre première entrevue il m’eût fait plus de politesses que je n’en attendais, je n’étais pas sans inquiétude. Je craignais quelque perfidie de sa part, et comme j’étais entièrement en son pouvoir je crus devoir essayer de me le rendre favorable par quelque présent. En conséquence, lorsque je retournai vers lui, le soir, je pris une poire à poudre, du tabac, un peu d’ambre et mon parasol. Je ne doutai pas qu’on ne visitât mon bagage. Pour éviter qu’on ne me prît certains articles, je les cachai dans le toit de la maison où je logeais, et, voulant surtout conserver un habit bleu, qui était tout neuf, je m’en revêtis.
L’ensemble des maisons occupées par le roi et par sa famille était entouré d’une très haute muraille de terre, qui en faisait une espèce de citadelle. Cette enceinte était divisée en différentes cours. A la première entrée, je vis un homme en faction avec un fusil sur l’épaule, et pour pénétrer jusqu’au roi il me fallut passer par un chemin tortueux, et par différentes portes, à chacune desquelles il y avait des sentinelles.
Quand nous arrivâmes à l’entrée de la cour dans laquelle était l’appartement du roi, mon guide et mon interprète, se conformant à l’usage, ôtèrent leurs sandales. Le premier prononça alors très haut le nom du roi, et le répéta jusqu’à ce que ceux qui étaient dans l’appartement lui répondissent. Nous trouvâmes le roi assis sur une natte, et ayant deux de ses gens auprès de lui. Je lui répétai ce que je lui avais dit au sujet de mon voyage, et les raisons que j’avais de traverser son pays, mais il ne parut qu’à demi satisfait. L’idée de voyager par curiosité lui était totalement étrangère. Il dit tout uniment qu’il ne croyait pas possible qu’un homme de bon sens pût entreprendre un voyage aussi périlleux dans le seul dessein de voir le pays et ses habitants.
Je lui offris de lui montrer mon portemanteau et tout ce qui m’appartenait ; alors il fut convaincu de la vérité de ce que je lui disais. Ses soupçons n’avaient d’autre fondement que l’idée où il était que tout homme blanc devait nécessairement faire le commerce. Il fut très content des présents que je lui fis. Mon parasol, surtout, lui fit un très grand plaisir. II l’ouvrit et le ferma plusieurs fois et ses deux officiers, ainsi que lui, ne pouvaient se lasser de l’admirer. Ils furent aussi quelque temps sans pouvoir comprendre l’usage d’une si merveilleuse machine.
Lorsque je voulus prendre congé du roi, il me pria de rester encore un moment. Puis il commença un long discours à la louange des Blancs ; il vanta leurs immenses richesses et leur générosité. Ensuite il passa à l’éloge de mon habit bleu, dont les boutons jaunes semblaient être singulièrement de son goût ; et il finit par me prier de le lui donner, m’assurant, pour me dédommager de ce sacrifice, qu’il le porterait dans toutes les grandes occasions, et qu’il informerait tous ceux qui le lui verraient de mon extrême libéralité envers lui.
La demande d’un prince africain qui est dans ses Etats ne diffère guère d’un commandement, surtout lorsqu’il l’adresse à un étranger. Ce n’est qu’une manière d’obtenir avec douceur ce qu’il a le pouvoir de prendre par force. Or, comme il n’était pas de mon intérêt d’offenser par un refus le roi de Bondou, j’ôtai tranquillement mon habit, le seul que j’eusse alors qui valût quelque chose, et je le mis aux pieds de ce prince.
Flatté de ma complaisance, il me fit donner beaucoup de provisions, et il me pria de revenir chez lui le lendemain matin. Je ne manquai pas de m’y rendre. Le monarque était sur son lit. Il me dit qu’il était malade et qu’il désirait être saigné. Mais je n’eus pas plutôt lié son bras et ouvert ma lancette que le courage lui manqua. Il me pria de différer l’opération jusqu’à l’après-midi, attendu, dit-il, qu’en ce moment il se trouvait mieux qu’il n’avait été ; et il me remercia très affectueusement de la promptitude avec laquelle je m’étais préparé à le servir. Il ajouta que ses femmes désiraient beaucoup me voir, et qu’il serait charmé que je voulusse leur rendre visite.
Aussitôt un des officiers du roi eut ordre de me conduire dans l’appartement des femmes. A peine fus-je entré dans leur cour que je me vis environné de tout le sérail. Les unes me demandaient des médecines, les autres de l’ambre, et toutes voulaient éprouver ce grand spécifique des Africains, la saignée. Ces femmes étaient au nombre de dix à douze, la plupart jeunes et jolies, et portant sur la tête des ornements d’or et des grains d’ambre.
Elles me plaisantèrent avec beaucoup de gaieté sur différents sujets ; elles riaient surtout de la blancheur de ma peau et de la longueur de mon nez, soutenant que l’une et l’autre étaient artificielles. Elles disaient qu’on avait blanchi ma peau en me plongeant dans du lait lorsque j’étais encore enfant, et qu’on avait allongé mon nez en le pinçant tous les jours, jusqu’à ce qu’il eût acquis cette conformation désagréable et contre nature.
Pour moi, sans disconvenir de ma difformité, je fis un très grand éloge de la beauté africaine. Je vantai la brillante noirceur de leur teint, l’agréable aplatissement de leur nez. Mais elles me répondirent que dans le royaume de Bondou on faisait peu de cas de la flatterie, ou, comme elles l’appelaient avec emphase, de la bouche de miel. Cependant, pour me témoigner leur reconnaissance de ma visite, ou de mes éloges auxquels je crois qu’elles n’étaient pas aussi insensibles qu’elles affectaient de le paraître, elles me firent présent d’une jarre de miel et de quelques poissons qu’elles envoyèrent chez moi. On me pria, en même temps, de retourner chez le roi avant le coucher du soleil.